L’épargne
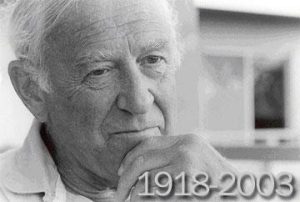
Les problématiques
- L’épargne est-elle une consommation différée ?
- Comment expliquer les comportements d’épargne ?
1 – Définitions, mesure et évolutions
Définition – L’épargne est la partie non consommée du revenu. L’épargne nationale est la somme des épargnes constituées par les administrations publiques (A.P.U) lorsque leur budget est en excédent, par les entreprises lorsqu’elles mettent en réserve une partie de leurs profits et surtout par les ménages. Structurellement en capacité de financement, leur épargne constitue l’essentiel de l’épargne nationale. C’est pourquoi l’analyse économique se focalise sur elle. Leur épargne dite non financière est constituée de placements immobiliers. Sous sa forme financière, elle est conservée sous forme liquide (livrets d’épargne) ou est placée sur les marchés financiers (achats de titres, assurance-vie)
Mesure – La comptabilité nationale définit l’épargne des ménages comme la différence entre leur revenu disponible brut (R.D.B) et leur consommation finale ; le taux d’épargne des ménages correspond au rapport Epargne Brute/R.D.B
Evolution – Les données de la comptabilité nationale montrent que ce taux a augmenté de façon tendancielle entre 1950 (16,5%) et 1975 (22,3%) puis a fortement diminué avec un point bas en 1987 (11,1%). Puis il remonte et s’élève aujourd’hui à environ 15% du R.D.B.
2 – La relation épargne – investissement
Si les ménages sont structurellement en capacité de financement ce n’est pas le cas des entreprises qui pour financer leurs investissements ont besoin de faire appel à l’épargne des ménages. Cela amène à considérer le lien épargne/investissement qui fait l’objet de deux analyses contradictoires
Dans l’approche néo-classique l’épargne est le résultat d’un choix entre consommation présente et future. Ce choix dépend du taux d’intérêt qui est la récompense de la renonciation à une consommation immédiate. Sur le marché des fonds prêtables, les variations du taux d’intérêt permettent automatiquement d’équilibrer l’épargne et l’investissement à un niveau assurant le plein emploi
Eléments à retenir
- Capacité et besoin de financement : dans le premier cas l’épargne du secteur institutionnel considéré excède sa Formation Brute de Capital Fixe (F.B.C.F) et dans le second c’est l’inverse
- Revenu disponible brut: revenu après cotisations sociales et impôts directs, mais avant transferts sociaux en nature. Il est disponible pour la dépense de consommation finale et l’épargne
Dans l’approche keynésienne en revanche l’épargne apparaît comme un résidu, comme ce qui reste après qu’on ait consommé, et non comme le résultat d’un choix entre consommation présente et future. Elle peut être thésaurisée et sortir du circuit économique. Elle n’engendre donc pas « automatiquement » une demande correspondante de biens d’investissement. Or lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi mais moins vite, ce qui mécaniquement grossit l’épargne dont le volume croissant est de plus en plus difficile à réemployer de manière productive.
L’épargne S est donc passivement liée au revenu dont elle est une fonction croissante alors que l’investissement I dépend de la demande anticipée par les entrepreneurs. N’étant pas régie par les mêmes facteurs il y a fort peu de chances que S et I s’égalisent précisément à un niveau compatible avec le plein emploi des facteurs de production
Dans cette approche le taux d’intérêt ne joue un rôle que sur la répartition de l’épargne entre la détention de titres et la détention de monnaie, c’est à dire sur sa structure mais pas sur son niveau. Il devient la récompense de la renonciation à la liquidité
3 – Les apports de Friedman et Modigliani et leur remise en cause
La théorie du revenu permanent élaborée par Friedman considère que, étant rationnels, les individus sont capables de planifier leur consommation et leur épargne sur l’ensemble de leur vie. Rationnels et informés, ils sont capables de calculer le flux de revenus que sur une longue période peut leur procurer leur capital humain et leur patrimoine. L’épargne constituée est une fraction délibérément choisie de ce revenu permanent ; elle permet de gérer les écarts entre revenu courant et revenu permanent
La théorie du cycle de vie de Modigliani considère que l’épargne des ménages est liée à leur position dans le cycle de vie (soit à leur âge) : à la vie active correspond une phase d’emprunt puis une phase d’épargne suivie d’une phase de désépargne de la retraite au décès. Le taux d’épargne d’une économie dépend alors de sa structure démographique.
Les évolutions récentes altèrent la portée de ces analyses. Les pays développés à économie de marché (P.D.E.M) ont été marqués par le chômage et par le vieillissement de leur population avec des difficultés croissantes de financement de la protection sociale. L’avenir paraissant plus incertain, par précaution les ménages épargnent davantage, en particulier les personnes âgées, ce qui remet en cause le schéma de Modigliani. Par ailleurs dans les sociétés riches les ménages ont accès à une très large palette d’outils financiers qui leur permettent de placer comme de s’endetter et même de faire les deux simultanément. Ils sont donc conduits à arbitrer entre épargne et endettement en fonction des taux d’intérêt et des possibilités d’emprunt du moment, ce qui complexifie l’analyse. On a ici l’exemple des ménages américains qui à la fois détiennent beaucoup d’épargne placée en bourse et sont très endettés auprès du système bancaire.
Elément à retenir
- La loi psychologique fondamentale : formulée par Keynes elle énonce que lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi mais moins vite. De ce fait la part de l’épargne dans l’utilisation du revenu croit en même temps qu’il augmente.