L’économie vue par Marx
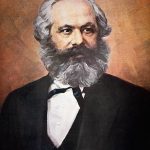
Karl Marx
Les problématiques
- Marx est-il le dernier des classiques ?
- Le capitalisme est-il condamné à s’autodétruire ?
I – Marx : biographie et contexte
Vers 1850 le courant classique s’essouffle. Il est contesté par Karl Marx qui utilise les mêmes outils d’analyse pour les retourner contre lui. Né à Trèves en 1818, Marx suit des études de philosophie à Bonn puis à Berlin où il découvre les œuvres de Feuerbach et Hegel. Du premier il retient les positions sur l’athéisme et du second le principe du raisonnement dialectique. Devenu journaliste d’opposition, il est exilé à plusieurs reprises ; en 1849 il s’installe à Londres avec l’aide d’Engels, industriel d’origine allemande qui vit en Angleterre et lui a fait découvrir les textes de Ricardo. Sa production intellectuelle mêle la philosophie allemande, les idées politiques françaises et l’économie politique anglaise. Marx est en particulier l’auteur du Capital (Livre 1, 1867). C’est aussi un homme d’action qui contribue à créer la première internationale à Londres en 1864. Il meurt en 1883 en laissant une œuvre considérable mais inachevée. Cette œuvre s’inscrit dans le contexte d’un capitalisme triomphant mais qui produit des tensions sociales de plus en plus vives. Selon Marx elles sont inhérentes au fonctionnement du mode de production capitaliste (M.P.C) que la mission du prolétariat est de renverser, ce qui suppose de l’éclairer sur les mécanismes cachés de son fonctionnement.
II – Sa vision de la société
ll a des rapports entre les hommes et la société une conception holiste, matérialiste et dialectique.
- Holiste car il postule que la société forme un tout structuré par des rapports sociaux qui s’imposent à ses membres, indépendamment de leur volonté.
- Matérialiste car pour Marx ce sont les conditions matérielles d’existence qui déterminent tout le reste : « Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine la réalité sociale, c’est la réalité sociale qui détermine leur conscience ». Ce qui prime ce sont les infrastructures, c’est-à-dire ce qui se trouve au fondement matériel de la vie en société ; en dérivent les superstructures que sont le droit, les institutions, la culture, l’idéologie etc.
- Dialectique en ce sens que les rapports de force sont au principe de l’évolution des sociétés. En leur sein apparaissent des contradictions entre forces productives et rapports de production qui sont au principe de la lutte des classes.
Les mots à retenir
- Forces productives: ce terme englobe les moyens matériels de production, les travailleurs, les savoir-faire, les connaissances techniques et scientifiques disponibles à un moment donné.
- Rapports de production : relations nouées entre les groupes sociaux pour produire avec dans le M.P.C un antagonisme fondamental opposant les salariés (le prolétariat) et les détenteurs des moyens de production (la bourgeoisie).
- Mode de production : sa base économique articule des forces productives et des rapports de production. Sur cette infrastructure s’édifie une superstructure façonnant le droit de la propriété, les institutions, les formes de l’Etat ou encore les idéologies
III – Son analyse de l’économie
Son pilier est la théorie de la valeur-travail qu’il emprunte à Ricardo. Toute valeur provient du travail qu’il s’agisse de travail vivant ou de travail mort. Le premier est celui qui est saisi au moment de son exécution. Il correspond à ce que Marx appelle le capital variable noté V. Le travail mort est le travail passé qui s’est cristallisé dans les objets produits, en particulier les moyens de production qui forment le capital constant noté C. Cette théorie est au cœur même de sa vision matérialiste du monde : les marchandises sont du travail mis en circulation. En définitive tout est travail et le capital est un rapport social (celui qui découle de la propriété privée des moyens de production). Marx s’appuie sur cette approche pour démontrer que le M.P.C est un système d’exploitation d’une classe par une autre en mettant en avant le concept de plus-value.
IV – Son interprétation de l’histoire
« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes ». (Le Manifeste du Parti Communiste, 1848). Au sein du M.P.C, la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, classe dont le mérite passé a été de porter les forces productives à un niveau jusqu’alors jamais atteint, conduit à la bipolarisation de la société. Elle s’inscrit sur un fond de crises de plus en plus fortes qui finiront par détruire le M.P.C.
Pour le montrer Marx s’appuie en premier lieu sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. De cette « loi » il déduit que le M.P.C est voué à subir des crises récurrentes de sous-consommation liées à l’insuffisance chronique du pouvoir d’achat du plus grand nombre. A court terme la fonction des crises est de dévaloriser le capital constant déjà installé et de restaurer la rentabilité des entreprises qui survivent. A long terme elles seront de plus en plus violentes jusqu’à la crise finale vouant le M.P.C à l’autodestruction.
Sur ce point, l’argumentation de Marx suit une deuxième piste en distinguant au sein de l’économie la section 1 des biens de production et la section 2 des biens de consommation. Pour que l’économie fonctionne sans crise il faut que la production des deux sections évolue de manière équilibrée. Le M.P.C étant un système décentralisé fonctionnant sans coordination ex ante des activités, rien ne garantit qu’il en soit ainsi. Le déséquilibre est donc inévitable, ce qui provoque des crises récurrentes. Cette analyse a l’intérêt de ne pas reposer sur la théorie de la valeur-travail. Elle coexiste avec la première sans que Marx ait pu en faire la synthèse.
Les mots à retenir
- Plus-value : écart entre la valeur créée par le travail (soit la valeur des produits) et la valeur de la force de travail (soit le salaire). Groupe social détenteur des moyens de production, la bourgeoisie est en mesure de se l’approprier en totalité. On note que la force de travail est la seule marchandise à créer plus de valeur qu’elle n’en coûte.
- Loi de la baisse tendancielle du taux de profit – C ne fait que transmettre sa valeur aux produits qu’il permet de fabriquer et seul V génère de la plus value notée pl. Le taux de profit s’écrit : pl / C + V. Si on divise tout par V on obtient pl/V au numérateur (soit le taux de plus-value) et C/V + 1 au dénominateur (soit la composition organique du capital plus 1). Du fait de la concurrence, chaque entrepreneur est poussé à réduire ses coûts en substituant du capital constant (machines) au capital variable (travail). De ce fait C/V augmente et le taux de profit diminue. Pour freiner cette évolution, il faut augmenter le taux de plus-value par la mise au travail des femmes et des enfants, par la déqualification du travail et le chômage. L’exploitation se renforce et les tensions sociales s’exacerbent.