L’économie vue par le courant néo-classique
Les problématiques
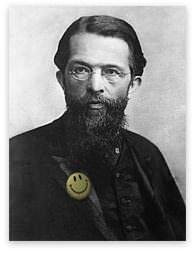
Carl Menger
- Pourquoi raisonner à la marge?
- Entre classiques et néo-classiques y-a-t-il continuité ou rupture ?
- Qui représente ce courant aujourd’hui?
I- La« révolution marginaliste » et ses premiers prolongements
Là où Marx critique le capitalisme, les auteurs néo classiques le défendent. Proches des classiques par leurs prémices et par leurs conclusions, ils renouvellent complètement l’analyse entre le point de départ et le point d’arrivée en récusant la théorie de la valeur-travail.
La première génération réunit trois auteurs qui sans se connaître mettent simultanément au centre de l’analyse le concept d’utilité marginale et ont de ce fait été qualifiés de marginalistes : l’anglais Stanley Jevons (1835/1882), l’autrichien Carl Menger (1840-1921) et le français Léon Walras. En sont issues différentes écoles. A Cambridge (G.B) Alfred Marshall (1842-1924) met l’entreprise et non le consommateur au point de départ de l’analyse, approfondit celle des coûts, introduit le raisonnement en équilibre partiel, propose une représentation graphique des courbes d’offre et de demande (la croix de Marshall), ou encore met à jour les notions d’économie d’échelle et de surplus du consommateur. A Lausanne, Vilfredo Pareto poursuit l’oeuvre de Walras en complétant son approche en termes d’équilibre général par ses travaux sur la notion d’optimum. A Vienne Eugen Böhm-Bawerk et Friedrich Von Wieser développent des approches originales, le premier sur le capital comme détour de production et le second en centrant l’analyse sur le système des prix conçus comme des signaux d’information indispensables au calcul rationnel des agents. En Suède, les recherches de Knut Wicksell (1851-1926) sur le taux d’intérêt ouvrent la voie à celles de Keynes.
II – La théorie néo-classique de la valeur
Contrairement aux Classiques, pour qui le travail constitue le fondement objectif et la mesure de la valeur, les néo-classiques développent une théorie subjective de la valeur qui la fait dépendre de l’utilité des biens dans un contexte de rareté, ce qu’exprime le concept d’utilité marginale
Du côté de la demande joue la fonction d’utilité du consommateur qu’il maximise par le choix de la meilleure meilleure combinaison possible de biens.
Du côté de l’offre interviennent les coûts de production qui sont fonction de la rareté. Chaque entreprise cherche à maximiser son profit en choisissant la combinaison de capital et de travail qui lui permet de minimiser ses coûts.
Eléments à retenir
- Utilité marginale : supplément de satisfaction procuré par la consommation d’une unité supplémentaire d’un bien
- Productivité marginale : supplément de production apporté par l’emploi d’une unité supplémentaire de capital ou de travail
- Equilibre partiel : pour le déterminer on considère ce qui se passe sur un marché en particulier en faisant abstraction de tous les autres (clause « toutes choses égales par ailleurs »)
- Equilibre général : vecteur de prix assurant l’équilibre simultané sur tous les marchés considérés comme interdépendants (ce qui se passe sur l’un d’eux affecte tous les autres)
- Optimum de Pareto : situation telle qu’on ne peut plus améliorer la situation d’un individu ou d’un groupe sans dégrader celle d’un autre. L’atteindre garantit que les ressources productives sont mises en œuvre de la manière la plus efficace possible.
Dans cette perspective Marshall (1842–1924) montrera que le prix s’établissant au point d’intersection d’une courbe d’offre et d’une courbe de demande, correspond de ce fait même à la valeur des biens reposant sur l’utilité (côté demande) et la rareté (côté offre). Cette théorie dite symétrique de la valeur établit qu’il est aussi vain de se demander ce qui de l’utilité ou de la rareté détermine la valeur que de s’interroger sur celle des deux lames d’une paire de ciseaux qui coupe effectivement une feuille de papier. De ce fait, nombre d’économistes en viendront à considérer que le débat sur la valeur relève de la philosophie et qu’en économie on peut se contenter d’une théorie des prix.
III – L’allocation des ressources selon les néo-classiques
Ils s’intéressent aux conditions d’équilibre sur les marchés et non à l’accumulation et à la croissance. Ils cherchent les critères permettant aux agents de procéder à la meilleure utilisation possible de ressources données en facteurs de production. L’objet de l’économie devient l’affectation optimale de ressources rares qui ont plusieurs usages possibles.
Ils mettent sur le même plan le capital, considéré comme un ensemble de biens physiques, et le travail, qui n’est plus la source de la valeur. Les facteurs de production : capital, travail, terre, s’ échangent sur des marchés de facteurs. S’ils sont concurrentiels, leurs rémunérations sont égales à leur productivité marginale en valeur. Chaque facteur reçoit alors sa juste rémunération, liée à sa contribution productive. Ce changement est fondamental car il escamote la problématique, classique à l’origine mais devenue marxiste, d’une répartition dominée par les affrontements entre classes sociales pour le partage du surplus. Les revenus autres que les salaires ne sont plus un prélèvement sur la valeur crée par le travail.
Les néoclassiques ont donc le sentiment d’avoir élaboré une théorie scientifique positive de l’économie conforme à la justice. Leurs principales conclusions sont que la flexibilité des prix, la concurrence parfaite et la rationalité des agents permettent d’atteindre une situation optimale pour la collectivité.
IV – Les néoclassiques contemporains
Aujourd’hui les économistes d’inspiration néo-classique forment le courant majoritaire et dominant en économie. Depuis la 2ème guerre mondiale ce courant s’est diversifié et ramifié dans plusieurs directions et notamment : celle du monétarisme avec Milton Friedman, celle des théories de la croissance avec Robert Solow, celle de la démonstration mathématique de l’existence de l’équilibre général avec Kenneth Arrow et Gérard Debreu. Aujourd’hui dans la mouvance néo-classique on trouve aussi l’école des anticipations rationnelles (Robert Lucas), celle des choix publics (James Buchanan, Robert Tullock), l’économie de l’offre (Arthur Laffer) ou encore la théorie du capital humain (Gary Becker)
Eléments à retenir
- Concurrence parfaite : elle se caractérise par l’atomicité du marché (acheteurs et vendeurs nombreux), l’homogénéité des produits (absence de différenciation), la transparence du marché (accès gratuit et sans délai de tous les agents à l’information disponible), sa fluidité (absence de barrières à l’entrée du marché et d’obstacles à la sortie) et la mobilité des facteurs de production (qui peuvent sans difficulté se déplacer d’un secteur en déclin vers un secteur en expansion). Si ces caractères sont réunis les prix de marché s’imposent à tous les agents. Preneurs de prix, ils ne peuvent les manipuler.
- Anticipations rationnelles : hypothèse selon laquelle les agents sont capables d’exploiter la totalité des informations disponibles pour élaborer leurs prévisions
- Ecole des choix publics : remettant en cause la notion d’intérêt général, elle questionne l’efficacité de l’intervention publique en montrant que les décisions politiques relèvent de calculs particuliers
- Courbe de Laffer : représentation graphique de l’adage selon lequel trop d’impôts tue l’impôt
- Capital humain : Stock de connaissances économiquement valorisables dont dispose un individu. Il varie en fonction des investissements consentis pour sa formation et de son état de santé